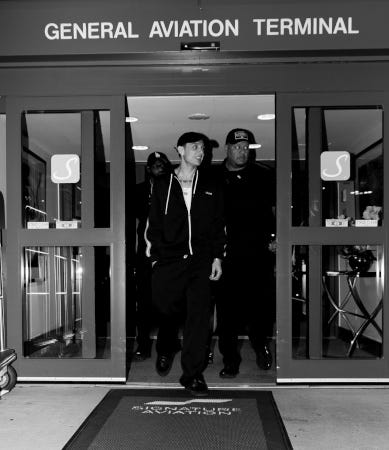Dans les archives : en Amérique latine
Des œuvres et des hommes
Chère lectrice, cher lecteur,
bienvenue dans ce deuxième volet de la série d’été d’Un Jour En Plus. La balade entre les archives et les continents se poursuit, avec cette fois-ci l’Amérique latine à l’honneur.
En attendant l’Europe la semaine prochaine, découvrons donc d’un peu plus près des nouvelles du Mexique, de l’Équateur, du Pérou et des autres nations du continent. Avec une bonne dose de musique, de cinéma et de tortues.
Bonne lecture et bel été !
Sortie ciné
Voilà mon genre d'info préférée, les découvertes pour lesquelles je fais ce travail. Elle est belle au début mais, quand on regarde derrière, plus belle encore.
Pour raconter l'histoire de ce festival de cinéma très spécial qui vient de clore sa première édition, il faut d'abord narrer celle de Kara Solar.
Cette fondation est née en 2018, en Équateur, grâce aux efforts conjoints de la population Achuar et d’un petit groupe d'anthropologues et d'ingénieurs. Le but initial était d’apporter l'énergie solaire au territoire de cette communauté autochtone. Pour "la libérer de la dépendance à l'essence" et pour relier ses tribus, éparpillées entre l'Équateur et le Pérou. Pour, en fait, l’aider à retrouver le plein usage de "ses autoroutes ancestrales, les fleuves".
Tout commence avec des pirogues modernes alimentées à l'énergie solaire (cinq à ce jour), qui vont peu à peu former un véritable réseau de transport sans perturber ni la nature, ni le mode de vie des Achuars. Trois ans plus tard, en 2021, le modèle commence à s'exporter (avec un petit coup de pouce de la pandémie de Covid, qui rend l'essence rare et chère) : "maintenant que nous savons que notre modèle est viable, nous aidons des communautés indigènes, au Brésil, au Pérou, aux îles Salomon et au Surinam à le reproduire", se félicite Karua Solar sur son site. En 2022, une première salle communale fonctionnant à l'énergie solaire a également été inaugurée.
Les ingénieurs ont ensuite fait la connaissance de cinéphiles, en la présence du collectif Tawna qui depuis 2017 défend la production et la diffusion de films réalisés par des indigènes d'Amazonie, sur des sujets qui les concernent. Pour reprendre leurs mots : "Nous cherchons à rendre visibles les principes de défense des territoires indigènes, à solidifier les héritages culturels de l'Amazonie, et à accompagner la jeunesse dans l'apprentissage de la communication audiovisuelle. Une "tawna" ["Pagaie", en français], c'est l'outil qui permet à un canoë d'avancer sur les cours d'eau. C'est notre symbole, car nous jouons le même rôle : connecter, unir, créer des liens entre les communautés et les territoires".
Peut-être faut-il le préciser : les tribus d'Amazonie ne vivent plus complètement à l'extérieur du monde. L'arrivée assez fracassante, dans les années 1990, du Chef Raoni (un Kayapo, lui) sur la scène internationale rappelle que les contacts et les échanges —mais aussi les combats, les invasions et les résistances— remontent à loin. Celles et ceux qui quittent leur village pour apprendre, pour travailler, pour découvrir, ont souvent à cœur de faire connaître leurs façons d'être, comme les menaces qui pèsent sur elles. C'est le cas par exemple, au sein de Tawna, de Enoc Merino Santi, devenue docteure en Anthropologie sociale à l'université de Rio, de Tatiana Lopez, une photographe Quechua, ou de Nixon Andy, documentariste et coordinateur de la Guardia Indegenia, un groupe militant "qui surveille son territoire ancestral".
Quand l'équipe de Kara Solar (et ses pirogues écolos) sympathise avec le collectif Tawna (et ses films venus d'ailleurs, enfin, vu de là-bas, d'ici), la seule conséquence logique est la création de Kanua : le premier festival de cinéma itinérant intégralement dédié aux peuples d'Amazonie.
Concrètement, le mois dernier, l'un des bateaux à énergie solaire de Kara Solar a traversé "377 kilomètres à travers les terres indigènes, s'arrêtant dans les villages qui jalonnent le fleuve, sur les territoires Kochwa, Shiwiar et Achuar, en suivant les rivières Bonanza, Pastaza et Capahuari". À son bord, un projecteur, un écran de cinéma et 29 films issus de neuf pays d'Amérique latine.
Des films comme Mari Hi, "une expérience onirique guidée par un chaman Yanomami". Comme Un dia de Cumbia, "voyage candide dans les souvenirs d'une femme Awajun". Ou Guanuna, l'enquête sur le meurtre d'un jeune villageois de 16 ans par 3 policiers brésiliens, depuis condamnés à 20 ans de prison.
La radio états-unienne The World s'est entretenue avec un membre de l'équipe, le soir de la dernière. La réalisatrice Elizabeth Swanson Andi Napu Kichwa, de la communauté Santu Urku, a raconté à l'animateur, en direct :
"Il pleut. Je suis entourée des toits de chaume, magnifiques, avec leurs motifs élaborés. Quand je les vois, je pense aux gens, aux membres de cette communauté, qui les ont fabriqués ensemble, et à leurs histoires tout aussi élaborées. Il y a un feu près de moi. C'est le dernier soir, notre dernier moment tous ensemble.
Le plus souvent, le chef de village souffle dans un cor en terre cuite pour prévenir les habitants que la projection va commencer. Les enfants se précipitent. Beaucoup de femmes, des grand-mères pour la plupart, ont préparé une boisson traditionnelle à partager. On rit beaucoup.
L'un des films qui a le mieux marché, c'est Allpamanda, ce qui veut dire "pour la terre" en Quechua. C'est sur la rébellion indigène de 1992. Beaucoup des plus âgés ont reconnu des proches dans des scènes. Ils disaient "Oh oui, je me souviens, j'y étais".
Ils parlent de celles et ceux qui sont décédés depuis, qui se sont battus, qui ont aussi accompli un travail remarquable. Beaucoup de papas et de mamans qui ont traversé, souvent pieds nus, la forêt amazonienne, la Cordillière des Andes, jusqu'à la capitale Quito, pour défendre leurs droits.
C'était très beau, de voir les enfants découvrir cette histoire".
The World (Chronique parue dans l’édition du 16 décembre 2023).
Qui paye son mezcal ?
Les modes ont leur raisons que la raison ignore. Et c’est pourtant à cette dernière de faire le boulot, et de trouver comment assouvir les passions, même nouvelles, même imprévues, même tombées du ciel.
Ainsi, sans crier gare, le monde s'est pris de passion pour le mezcal, l'eau-de-vie mexicaine distillée à partir de l'agave. Alors du mezcal, il a fallu en fournir au-delà de la limite des stocks —ou des plantes— disponibles.
En 10 ans, la production mexicaine de mezcal a augmenté de 700 %. Une grande majorité de ces bouteilles sont destinées à l'export, aux États-Unis surtout, qui en absorbent plus des deux tiers. De quoi étrangler les petits producteurs face à l’agressivité commerciale des méga distilleries, ravager les sols qui doivent nourrir de l'agave à tout va, dévaster les méthodes traditionnelles, ainsi que la biodiversité et, pour finir, l'agave elle-même, dont la diversité génétique s'érode.
Mais le mezcal traditionnel n'a pas dit son dernier mot. Civil Eats, "une source d'informations quotidiennes pour la pensée critique du système alimentaire américain", est allé visiter les paysans indépendants, qui se regroupent en coopératives afin de défendre les recettes originales de la boisson alcoolisée, et protéger leurs terrains, en cultivant dans le respect des sols.
Dans ce reportage passionnant, on fait la connaissance d'Erika Meneses, fondatrice, à la mort de son mari, de la marque Aguerrido —"Aguerri", en français. Elle nous fait visiter l'exploitation, nous introduit aux difficultés de la culture de l'agave, aux dangers que fait courir la production de masse à la région, à cause de la déforestation, de la monoculture et de l'épuisement des sols. On rencontre, aussi, Neta Spirits, coopérative regroupant douze familles de Oaxaca, la région du Mexique d'où sort 85 % du mezcal produit par le pays. Et bien d'autres.
Un voyage, poétique à sa manière, politique sans l'ombre d'un doute, dans les traditions ancestrales d'un boisson fantasmatique et solaire, à consommer toutefois, si vous voulez mon avis, avec modération.
Civil Eats (Chronique parue dans l’édition du 15 avril 2023).
Êtes-vous prêt pour une déferlante de variété mexicaine ?
Ce monde va trop vite. Alors que, après des années de doute, je commençais tout juste à comprendre la vague de la K-pop (la pop music sud-coréenne légère, acidulée, vive et contagieuse comme le diable), voici qu'arrive la déferlante de la variété mexicaine.
Le genre (ou plutôt les genres, comme les corridos, le norteño, la banda) ont atteint l'année dernière un record de 1,1 milliards de revenus cumulés selon la RIAA, l'association professionnelle des producteurs américains. Peso Pluma, à lui seul, constitue "l'une des croissances les plus explosives et exponentielles de l'ère du streaming musical”, selon Spotify.
Pour cette raison, c'est d'abord sur ce jeune homme de 23 ans, né Hassan Emilio Kabande Laija, que s'est penché le Washington Post. Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
Peso Pluma, dont le pseudonyme signifie "Poids Plume" en espagnol, a émergé comme possible prétendant au titre de star mondiale voilà trois ans, quand il a commencé à publier sa musique via le label indépendant californien El Cártel De Los Ángeles. (Il a depuis signé pour la Major Prakin Music, au sein de laquelle il a créé son propre label, Double P Records). Cette année, 8 de ses chansons ont atteint le Top 100 de Billboard. Son single "Ella Baila Sola" ("Elle danse seule"), écrit par Perdo Tovar, du groupe Eslabon Armado, s'est avérée le premier titre mexicain à atteindre le Top 10 du classement. (Il est désormais n°1 dans la catégorie Global Pop et, selon Spotify, a été streamé plus de 465 millions de fois)"
Outre un portrait du jeune homme, des tentatives d'explication du succès croissant, auprès des plus jeunes surtout, de la pop mexicaine dans toute sa variété et sur la planète entière, le Washington Post présente bien entendu d'autres idoles du genre : Los Tucanes de Tijuana, Grupo Firme, Conexíon Divina… Craquerez-vous pour ces dernières, trois jeunes filles aux guitares entraînantes, ou pour "Ella Baila Sola", le hit de Pluma qui, dans son clip, ferait craquer les cœurs les plus insensibles grâce à son smoking agrémenté d'une casquette plate fichée sur son incontournable coupe mulet ?
Pour ma part, j'ai un faible pour ce clip de DannyLux, 19 ans, qui a le mérite de rappeler combien c'est dur et beau d'être amoureux, quand on est adolescent —et cycliste.
The Washington Post (Chronique parue dans l’édition du 10 juin 2023).
Sauvetage amer
"Tout s'est bien passé ?
- Oui franchement. Les œufs de tortue, là… fondants juste comme il faut."
Une conversation qui hélas ne sera bientôt plus possible à cause des méchants woke ?
Eh bien non, pas du tout. Au Pérou, personne ne songe à interdire la consommation des œufs de tortue, bien trop populaire. Délicieuse même, quand on tend l'oreille aux amateurs et amatrices interviewées par Mongabay dans son reportage à Iquitos et dans les environs, aux abords de la rivière Tapiche. C’est même tout le contraire : si les écologistes locaux luttent si activement contre le trafic, c'est autant pour préserver la biodiversité que la perpétuation de ce mets, vu là-bas comme particulièrement bon pour la santé (même si la recherche pour l'instant ne confirme pas cette vertu).
Le trafic d'animaux sauvages est déjà une plaie au Pérou, rappelle la publication : sur ces vingt dernières années, les autorités ont saisi plus de 100 000 bêtes destinées au commerce illégal. L'application de la loi est rendue compliquée par le fait que la chasse n'est pas régulée, pour les communautés autochtones au moins, tant qu'il s'agit de subsistance. Seule la revente est interdite.
Lutter contre ce commerce illégal est plus compliqué encore pour les œufs de tortue : "Le problème, c'est que les couvées sont essentiellement un buffet à volonté", explique Aiden Colligan, biologiste à la tête du Tapiche Citizen Science Turtle Rescue Project. "Si un braconnier ne ramasse pas un nid, il le laisse simplement à la disposition du suivant. C'est comme passer devant un tas de billets."
Dans un pays "où l'on mange des testicules de taureau, de la viande séchée de lama et du cochon d'Inde", les œufs de tortue sont toujours assurés de trouver un débouché. On en consomme au quotidien, mais c'est aussi la base de plusieurs plats traditionnels (dont le magazine donne quelques exemples de recettes, pour les curieuses et curieux). Pour de bons œufs de tortue, comptez en tout cas 4 dollars la dizaine, ou 13 dollars le nid sur les étals du marché.
Alors, chaque année entre juin et août, les participantes et participants au Tapiche Rescue Project se lancent dans une tâche à la fois absurde et essentielle. Ils arpentent les berges de la rivière, ramassent tous les œufs qu'ils peuvent, puis les déposent dans des boîtes d'incubation, enterrées dans une réserve "à 12 heures (4 de bus, 4 de ferry et 4 de hors-bord) d'Iquitos, loin dans la jungle. Après l'éclosion, ils prennent soin des bébés, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour être relâchés dans les rivières et les lagons qui bordent la réserve…"
L'opération de sauvetage a commencé en 2014. Elle peut même rémunérer quelques salariés, en plus des bénévoles toujours partants pour ces saines et laborieuses expéditions. Laborieuses, mais pas inefficaces : chaque saison, ce sont de 1 000 à 2 000 œufs qui sont ainsi sauvés. Souhaitons leur de bonnes et nombreuses baignades.
MongaBay (Chronique parue dans l’édition du 23 mars 2024).
La guérilla des plantes
Alors, ça pousse ? Ça pousse, ça pousse. Surtout en Colombie où la baisse de la déforestation se poursuit à un niveau spectaculaire : -29 % en 2022, -36 % en 2023 (par rapport, chaque fois, à l'année précédente). Et même -66 à -75 % dans les districts les plus épargnés. Ça représente 79 256 hectares déboisés en 2023 (contre 123 517 en 2022), "le chiffre le plus bas depuis 23 ans" s'est félicité le Président du pays, Gustavo Petro, élu en 2022. Des efforts qu'il espère poursuivre : il vise les zéro hectares rasés "pour préserver les poumons du monde".
Un résultat impressionnant dû pour partie "à un programme gouvernemental qui rémunère les agriculteurs en échange d’un travail de conservation de la nature", nous explique GoodPlanet, mais aussi à la paix avec la guérilla des FARC, selon la ministre de l'environnement. Une vision à nuancer, d'après l'AFP qui tient à préciser : "Les experts suggèrent que l’un des groupes armés, les dissidents des FARC (qui rejettent l’accord de paix signé en 2016 avec cette guérilla marxiste) qui se sont regroupés au sein de l’État-major central (EMC), choisit le rythme de la déforestation pour faire pression sur le gouvernement à la table des négociations".

Une méthode particulièrement redoutable, décryptait Al-Jazeera l'été dernier, dans un article dont le titre laissait peu de place à l'interprétation : "Le secret de la baisse de la déforestation en Colombie ? Les groupes armés."
Le média qatari écrivait alors :
D’après les experts […], les groupes armés rebelles ont eux-mêmes pris en main l'interdiction de la déforestation illégale. Selon Bram Ebus, chercheur spécialisé en criminalité environnementale au sein de l'ONG International Crisis Group, ces efforts visent à faciliter les négociations de paix avec le gouvernement de Petro, et son projet de "Paz Total", la paix complète."On constate qu'ils ont commencé à utiliser la lutte contre la déforestation comme un outil politique avant même le début des négociations", nous a-t-il expliqué.
Selon lui, les groupes armés ont anticipé "et compris qu'ils pouvaient renforcer leur main à la table des discussions s'ils devenaient un acteur majeur de la baisse de la déforestation en Amazonie". Le pays est embourbé dans un conflit interne depuis six décennies où s'affrontent, pour le pouvoir, forces gouvernementales, groupes paramilitaires, réseaux criminels et rebelles en arme.
Al-Jazeera explique que la paix signée avec les FARC, en créant un vide politique dans les régions reculées, a suscité un véritable appel d'air pour les trafiquants de toutes sortes. Initialement, l'anarchie de fait qui s'en est suivie a considérablement accru le rythme de la déforestation : +46 % en 2016, selon les chiffres officiels, toujours cités par Al-Jazeera.
Pour contrer ces ravages, le Président précédent, Ivan Duque, a eu recours à une stratégie militaire, qui visait surtout les installations illégales, souvent le fait de fermiers pauvres installés au cœur même des parcs nationaux.
Mais son successeur Petro, le premier Président de gauche de l'histoire colombienne, privilégie une autre approche. Il s'est engagé à réduire le phénomène à 140 000 hectares par an, en proposant des alternatives économiques et en signant des accords avec les communautés de l'Amazonie.
L'EMC —le commandement des dissidents des FARC décidés à poursuivre la guérilla— a sauté sur l'occasion. Pour se présenter en acteur incontournable de la région, il a carrément institué une interdiction totale de la déforestation dans les secteurs qu'il contrôle… et même mis en place une amende d'1 million de pesos par hectare pour les contrevenants (soit environ 250 euros). Au moins le temps du mandat de Petro, dont ils attendent "des solutions à long-terme pour les agriculteurs sans terres de l'Amazonie", en se disant représentants de ces derniers.
Même si, selon l'un des porte-paroles de l'EMC interrogé par Al-Jazeera, on trouve également derrière cette politique radicale "des préoccupations sécuritaires". Dans ses mots, ça donne l’aveu suivant : "Nous avons interdit la déforestation en Amazonie parce que nous sommes profondément une guérilla environnementale. Les arbres nous protègent et nous avons besoin d'eau pour nos opérations militaires". C'est ce qu'on appelle une symbiose.
Quand, dans les forêts cévenoles, une insurrection équipée de grenades et de fusils d'assaut imposera la protection de l'environnement pour protéger une guérilla marxiste vieille d'un demi-siècle, alors peut-être je prêterai l'oreille aux élucubrations de Gérald Darmanin. Et j'apprendrai aussi l'orthodontie car ce jour-là, les poules auront des dents.
GoodPlanet (Chornique parue dans l’édition du 13 juillet 2024).
Ça va au diable
Même chez soi, on n’est jamais loin de l'enfer, de l'horreur, du cauchemar. Tenez, Roni Bandini par exemple.
C'est un écrivain argentin, qui préfère se définir sur son Instagram comme un "maker contre-culturel" (un "maker", c'est un type doué pour le bricolage et l'impression 3D, capable de réparer et créer les objets indispensables à nos sociétés présentes et futures). Hélas, son voisin d'immeuble a une toute autre passion dans la vie : le reggaeton. Un genre musical "né à Porto Rico [qui] s'est ensuite diffusé dans toute la région", nous explique le Latin America Post. "Il mélange les rythmes latins, le hip hop et le son des Caraïbes pour toucher des millions de fans. Mais son immense succès a vite saturé le marché, divisant le public".
Toquer chez le voisin pour lui demander de baisser un peu le son est, hélas pour Roni mais heureusement pour nous, une tâche au-delà des capacités sociales de ce grand timide. Il lui a fallu trouver une autre solution. Il explique :
"J'ai un voisin qui passe cette musique enthousiaste et syncopée toute la journée, avec une grosse enceinte Bluetooth accrochée au mur […] Étant donné mes faibles aptitudes sociales, j'ai pensé à fabriquer une machine qui, grâce à l'intelligence artificielle, pourrait reconnaître quand on diffuse du reggaeton, et s'attaquer à l'enceinte grâce au Bluetooth."
Aussitôt dit, aussitôt fait. Ainsi naquit le Reggaeton Be Gone, qui fait exactement ce qui était prévu : il détecte le reggeaton, grâce à son intelligence artificielle, et envoie des signaux à l'appareil Bluetooth qui le diffuse pour l'éteindre ou, à défaut, le submerger de bruits parasites et de grésillements, afin de pousser son propriétaire à couper le son de lui-même.
Bandini a programmé méticuleusement sa machine pour qu'elle puisse identifier des centaines de chansons de reggaeton en analysant leur schéma sonore. "Il surveille les musiques diffusées et les compare à un modèle reposant sur l'intelligence artificielle pour déterminer si elle appartient à ce genre".
[…]
Mais il reconnaît que le Reggaeton Be Gone n'est pas parfait. Durant ses tests, les interférences produites ont été suffisantes… pour pousser son voisin à changer son enceinte de place. Ce qui indique le potentiel de l’appareil, mais aussi ses limites.
Il y a encore du progrès à faire pour venir à bout du reggaeton, mais la révolution est en marche. Roni a attiré l'attention de pas mal de clients. Puisque le monde se divise en deux catégories —ceux qui aiment le reggeaton, et les autres— et qu'en Amérique du Sud, à en croire le Latin American Post, ce genre musical est omniprésent au point de l'écœurement, quelques fans lui ont même demandé de passer à un stade de production industrielle.
Mais Roni Bandini ne voit pas les choses ainsi. "Je pense qu'il y a un réelle opportunité commerciale pour fabriquer cet appareil et le vendre en gros mais, comme disait Bartelby, "je préférerais ne pas"".
En revanche, il explique volontiers comment faire, notamment lors d'ateliers publics. À l'en croire, ça n'est pas compliqué mais, surtout, pas cher. Réduire les composants au minimum et identifier les plus abordables possibles fait entièrement partie du projet. Tous les héros ne portent pas de capes.
Certains se contentent d'une télécommande.
Latin America Post (Chronique parue dans l’édition du 25 janvier 2025).
De l’art en taule
Un salon international d'art contemporain souvent oublié approche à grands pas : la Biennale de La Havane, qui se tiendra dans la capitale cubaine du 25 novembre au 28 février. Cette édition marquera les 40 ans de son existence, autour de la thématique (légèrement hypocrite comme on va le voir) "Horizons en Partage".
De tous les visiteurs, un ou une seule pourra profiter pleinement d'une œuvre exceptionnelle, signée Luis Manuel Otero Alcántara. "Que vous soyez artiste, critique, collectionneur ou amateur d'art en visite à la biennale 2024, je vous invite à voir mon travail et même à en faire partie", explique-t-il. "J'appelle cette nouvelle installation Preuve de Vie. Il s'agira de choisir une personne pour me rendre visite en prison et passer une heure ou deux à discuter avec moi, d'art et d'autres sujets".
Artnews rappelle en effet :
Comme des centaines de Cubains, Otero Alcántara a été arrêté durant les manifestations anti-gouvernementales de 2021, qui critiquaient la chute du niveau de vie insulaire et la répression de la liberté d'expression. Il a été condamné en juin 2022 à 5 ans de prison, une décision alors condamnée par Amnesty International, qui la jugeait "emblématique" de la façon dont le régime de Cuba "utilise le système judiciaire pour criminaliser les voix critiques".
Co-fondateur du mouvement San Isidro pour la liberté, il s'était exprimé publiquement contre la censure artistique mise en place par le Président Miguel Díaz-Canel […] Par le biais de son compte Twitter, il a aussi rapporté les conditions brutales d'emprisonnement en vigueur à la prison de Guanajay, dont la mise à l'isolement prolongée ou l'insuffisance de nourriture et des soins procurés.
Officiellement, les "horizons partagés" célébrés par la biennale de La Havane 2024 sont ceux où l'ont peut "chercher ces points de connexion, ces espaces communs qui nous permettent d'aller, ensemble, de l'avant vers un futur plus équitable et durable" et, comme ils n'ont jamais dit "libres", ça joue.
Artnews (Chronique parue dans l’édition du 9 novembre 2024).
Séjour dans le temps
Que faire de sa vie quand on est, comme Thomas Kole, jeune Néerlandais au regard affable, un "artiste technique" maîtrisant à la fois l'informatique, la photographie et le montage vidéo ? Lui a choisi. Il veut "construire des ponts entre l'art et la programmation".
Une méthode de travail qui l’a d’abord amené à signer des projets plus ou moins compréhensibles pour le commun des mortels, comme le jeu vidéo Half-Line Miami, croisement improbable (et loué par la critique) entre Half-Life et Hotline Miami ou, plus fun, la modélisation de particules de fumée évoluant dans un champignon atomique.
Dernièrement —c'est là qu'on craque— il a signé la reconstitution en 3D de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, bâtie sur les eaux, qui deviendra plus tard Mexico.
"Nous sommes en 1518", raconte-t-il. "Mexico-Tenochtitlan, autrefois un village sans prétention au milieu du lac Texcoco, est devenue une métropole vibrante. Cette capitale d'un empire qui règne sur et reçoit le tribut de plus de 5 millions de sujets abrite 200 000 personnes : des fermiers, des artisans, des marchands, des soldats , des prêtres et des aristocrates. C'est l'une des plus grandes villes du monde. […] À l'aide de sources historiques et archéologiques, et grâce à l'expertise de bien des soutiens, j'ai tenté de ramener cette ville iconique à la vie".
Alors, attention : Thomas est un artiste indépendant, pas un studio de jeu vidéo au budget annuel de centaines de millions d'euros. Il ne s'agit donc pas, ici, de se balader virtuellement dans les rues aux côtés de centaines de milliers d'habitants mais simplement, si l'on peut dire, d'une reconstitution en trois dimensions à découvrir en images fixes. En photos, quoi. En cartes postales. Une balade malgré tout, donc, virtuelle et temporelle, émaillée de commentaires sobres et clairs.
On découvre une cité fascinante. Bâtie sur un lac gigantesque et rationnellement. "L'organisation, en grille, est le reflet d'une ville fondée sur le principe de hiérarchie. Les quartiers sont planifiés, chacun étant doté de son propre marché, de ses écoles, de ses lieux de culte. Les canaux sont entretenus régulièrement, pour assurer le transport des humains comme des marchandises. Une série de ponts relie le tout."
Il y a aussi des zones plus larges : l'ancienne ville de Tlatelolco, bientôt aspirée par sa grande sœur ; le Bassin, dominé par deux volcans, d'où s'écoulent eaux de pluie et de source ; il y a les chinanmpas, ces endroits peu profonds, comblés de terre, où l'on fait pousser du maïs, des haricots, des courges, des épices et des fleurs… Et il y a la Grande Pyramide, d'un blanc étincelant, surplombant le tout, et assurant à la population la bienveillance de Huitzilopochtli, dieu de la guerre, de Tlaloc, dieu de la pluie et de l'agriculture, et de Quetzalcotal, le Serpent à plumes.
Il y a encore de splendides photos de nuit, où le ciel lui-même est illuminé : "Pour marquer l'achèvement du cycle calendaire, qui durait 52 ans, tous les feux du Bassin étaient éteints, puis rallumés, à partir d'une seule source. C'était la Cérémonie du Feu Nouveau. Celui de 1507 fut le dernier de l'empire, avant la conquête."
Visitez Tenochtitlan… en choisissant de vous rappeler, ou non, que la source en question, allumée au moment où paraissait dans la nuit la constellation d'Orion, provenait d'un faisceau enflammé et placé sur la poitrine d'un homme dont on avait arraché le cœur (afin de servir de combustible) : quand en surgissait la première étincelle, le prêtre pouvait alors allumer le feu d'où, torche après torche, les habitants iraient chercher la lumière du nouveau cycle, et alimenter tous les foyers de la ville, sous les cris d'extase, d'horreur et de douleur des sacrifices humains pratiqués en nombre cette nuit-là parce que, vous comprenez, il faut ce qu'il faut.
Un Portrait de Tenochtitlan (via Mitu) (Chronique parue dans l’édition du 9 septembre 2023).
© 2025 PostAp Mag.